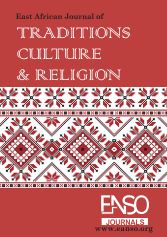Analepse, Prolepse Et Pouvoir Narratif Dans Puissions-Nous Vivre Longtemps D’imbolo Mbue
Abstract
Dans le paysage littéraire contemporain, Imbolo Mbue se distingue par sa capacité à tisser des récits qui résonnent avec les luttes pour la justice et l’autodétermination. Puissions-nous vivre longtemps (2022) son deuxième roman, ne fait pas exception. Cette œuvre explore la résilience d’une communauté, Kosawa, face à l’oppression d’une multinationale pétrolière. Au cœur de cette lutte, la temporalité narrative devient un instrument de pouvoir. Thula, une jeune femme de Kosawa, utilise l’analepse et la prolepse pour reconstruire le passé, contester le présent et imaginer un avenir où sa communauté retrouve sa dignité. Cette étude entreprend une exploration de ces manipulations temporelles, les considérant comme une stratégie délibérée pour arracher l’autorité narrative aux griffes des pouvoirs exploiteurs. Le problème de recherche central réside dans la dissonance entre la temporalité imposée de l’hégémonie corporative et la compréhension indigène et cyclique du temps, un conflit qui se manifeste dans la lutte de la communauté pour articuler sa propre histoire et son avenir. Dès lors, comment les stratégies narratives anachroniques, en particulier l’analepse et la prolepse, déployées dans Puissions-nous vivre longtemps d’Imbolo Mbue, se manifestent-elles en tant qu’instruments de revendication d’une autorité narrative, tout en contestant les structures temporelles imposées par les forces exploratrices ? Les objectifs de cette recherche sont multiples. De façon respective, elle vise à examiner les instances et les fonctions spécifiques de l’analepse et de la prolepse dans l’architecture narrative du roman à l’étude, en élucidant leur rôle dans la construction d’un cadre temporel non linéaire ; à démontrer comment ces perturbations temporelles facilitent l’articulation d’une mémoire collective et la projection des conséquences futures, remettant ainsi en question les récits monolithiques du pouvoir de l’entreprise. La présente recherche emploie l’approche méthodologique fondée sur la narratologie, complétée par les études temporelles postcoloniales et l’analyse critique du discours. À travers un examen méticuleux des disjonctions temporelles du roman, cette étude montrera comment le roman de Mbue perturbe la chronologie normative pour révéler l’impact durable des traumatismes historiques et la prescience de la dévastation écologique. L’analyse prendra en compte deux axes principaux : « déconstruction de l’hégémonie temporelle » et « émergence de voix prophétiques »
Downloads
References
Arunava, M. (2024). Environmental Degradation: A Case Study of Imbolo Mbue’s How Beautiful We Were. International Journal of Creative Research Thoughts, 12(8), b498-b502, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4920453
Bal, M. (1977). Narratologie, les instances du récit: Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes. Éditions Klinckseick.
Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. Routledge.
Chakrabarty, D. (2009). Provincialiser l’Europe : la pensée postcoloniale et la différence historique. Amsterdam.
DeLoughrey, E. M. (2019). Allegories of the Anthropocene. Duke University Press.
van Dijk, T. A. (1985). Discourse and Literature: New Approaches to the Analysis of Literary Genres. John Benjamins Publishing Company.
Ehanire, B. (2023). The Weapons of Subjugation in Imbolo Mbue’s How Beautiful We Were. ALT 40: African Literature Comes of Age, 107-118. https://doi.org/10.1515/9781800105676-010
Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The Critical Study of Language. Longman.
Genette, G. (1972). Figures III. Éditions du Seuil.
Genette, G. (1980). Discours du récit. Éditions du Seuil.
Junaid, S. et al. (2024). The Portrayal of African Woman’s Struggle Reflected in the Novel How Beautiful We Were by Imbolo Mbue (2021). ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 7(2), 275–284. https://doi.org/10.34050/elsjish.v7i2.3488
Karmakar, G. & Chetty, R. (2023). Extraction and Environmental Injustices: (De)colonial Practices in Imbolo Mbue’s How Beautiful We Were. eTropic: electronic journal of studies in the Tropics, 22(2), 126-147. DOI: http://dx.doi.org/10.25120/etropic.22.2.2023
Mbue, I. How Beautiful We Were. Random House, 2021.
Mbue, I. (2022). Puissions-nous vivre longtemps. Pocket.
Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press.
Stambler, A. (2023). Feeling Implicated by Fiction: Imbolo Mbue’s How Beautiful We Were and the Remaking of Human Rights Narrative. Parallax, 29(4), 455- 475. https://doi.org/10.1080/13534645.2024.2329409
Vincent J. (2001). Poétique des valeurs. Presses Universitaires de France.
Vincent, J. (2001). L’Effet-personnage dans le roman. Presses Universitaires de France.
Xausa, C. (2023). ‘From this Love we’ll Demand our Rights, and we shall Win’. A Postcolonial Ecocritical Reading of Imbolo Mbue’s How Beautiful We Were. Il Tolomeo, 25, 197‑212. DOI 10.30687/Tol/2499‑5975/2023/01/015
À propos de l’auteur
Daniel Tia est diplômé de l’Université Felix Houphouet-Boigny ; il a mené une thèse de doctorat sur les œuvres fictionnelles de Paule Marshall. Ses recherches portent sur les questions postmodernes/postcoloniales, la construction identitaire, le genre, l’immigration, l’espace subjectif et la transgression. Il enseigne la littérature américaine dans l’institution susmentionnée. Il est membre de Laboratoire de Littératures et Écritures des Civilisations (LLITEC). Il est examinateur pour les revues suivantes, International Journal of Culture and History (IJCH), International Journal of Social Science Studies (IJSSS) et International Journal of European Studies (IJES).
Copyright (c) 2025 Daniel Tia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.